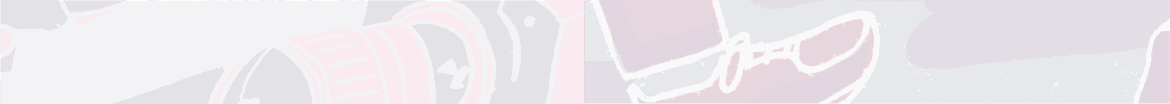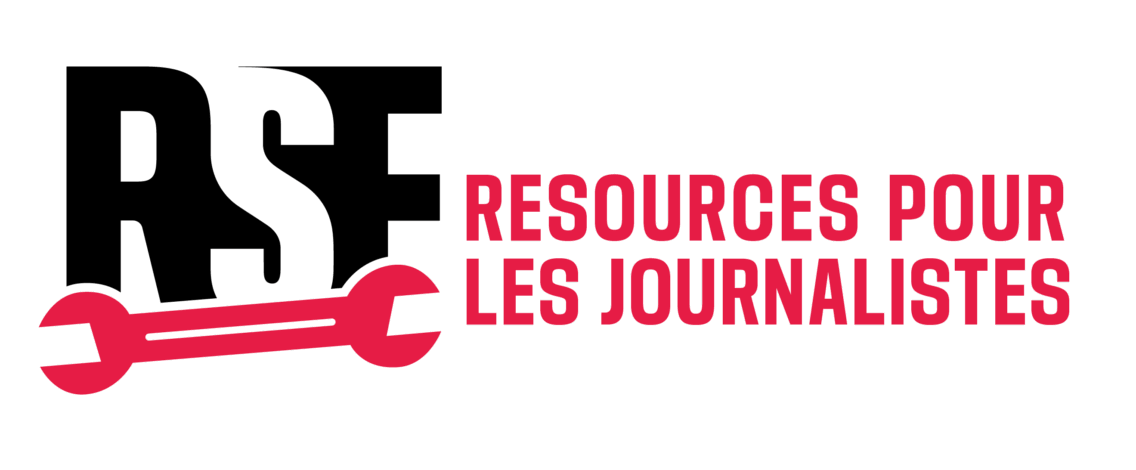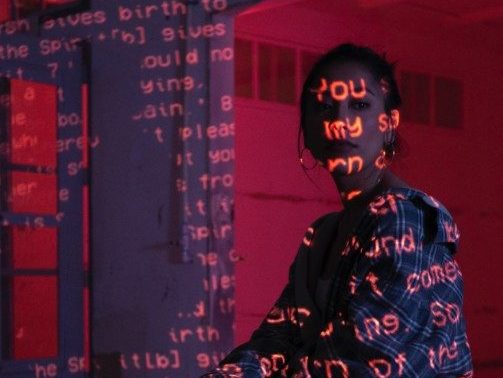Le harcèlement en ligne et le swatting sont des tactiques de cyberharcèlement fréquemment utilisées contre les journalistes. Dans ce premier article d’une série en trois volets consacrée au cyberharcèlement, Reporters sans frontières (RSF) propose des mesures préventives face à ces formes d’attaques.
Le harcèlement en ligne et le swatting sont des pratiques destinées à intimider ou à menacer les journalistes, souvent avec des conséquences dans la vie réelle qui peuvent mettre en danger leur sécurité physique. Ces deux comportements, le cyberharcèlement et le swatting, sont illégaux dans la quasi-totalité des pays. Comme d’autres formes de harcèlement numérique, ces attaques touchent de manière disproportionnée les femmes journalistes.
- Le harcèlement en ligne, ou stalking, consiste à persécuter ou harceler une personne, un groupe ou une organisation en leur infligeant une attention indésirable et obsessionnelle sur internet. Les tactiques de cyberharcèlement incluent les fausses accusations, les menaces, la surveillance des activités en ligne, le vandalisme numérique ou le chantage, souvent associés à un harcèlement réel dans la vie quotidienne.
- Le swatting est une autre forme de harcèlement qui consiste à envoyer, sous de faux prétextes, des équipes d’intervention d’urgence – comme la police – au domicile d’une personne ciblée. Ces attaques visent à effrayer, perturber ou discréditer leurs victimes.
Dans les deux cas, les agresseurs restent généralement anonymes. Ils peuvent aller de simples « trolls » en ligne, agissant par hostilité envers le travail ou les opinions d’un journaliste, à des individus rémunérés par des entités cherchant à nuire. Dans un cas récent aux États-Unis, des membres d’un groupe néonazi ont ciblé des journalistes ayant révélé publiquement l’identité de leurs membres. Les agresseurs ont appelé la police pour provoquer des interventions dans les bureaux des journalistes et les ont menacés par téléphone et tracts.
Mesures préventives
Supprimer les informations de localisation : bien qu’il soit difficile de prévenir totalement ces attaques, les journalistes peuvent réduire les risques en supprimant autant que possible les informations personnelles accessibles en ligne. Ils peuvent notamment retirer leur adresse des registres officiels, désactiver la géolocalisation dans leurs publications sur les réseaux sociaux et masquer leur adresse IP à l’aide d’un VPN ou d’autres outils de cybersécurité.
Documenter les violations : en cas de harcèlement ou de swatting, les journalistes doivent systématiquement conserver des preuves de chaque incident illégal (captures d’écran, photos, enregistrements téléphoniques). Ces éléments pourront servir de pièces justificatives dans le cadre d’éventuelles poursuites judiciaires ou d’enquêtes.
Saisir la justice : le cyberharcèlement et le swatting étant interdits dans la plupart des pays, les journalistes concernés doivent se renseigner sur leurs droits et les recours disponibles dans leur juridiction. Ils peuvent déposer plainte auprès des autorités et solliciter l’aide d’un avocat de confiance pour initier une procédure légale.
→ Lire la partie 2 : attaques par déni de service (DDoS) et bombardement de messages
→ Lire la partie 3 : doxxing