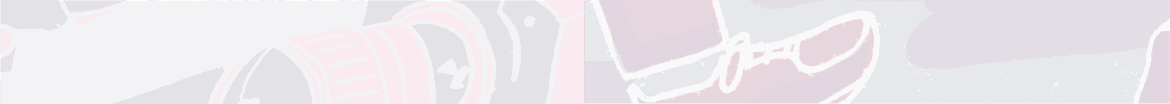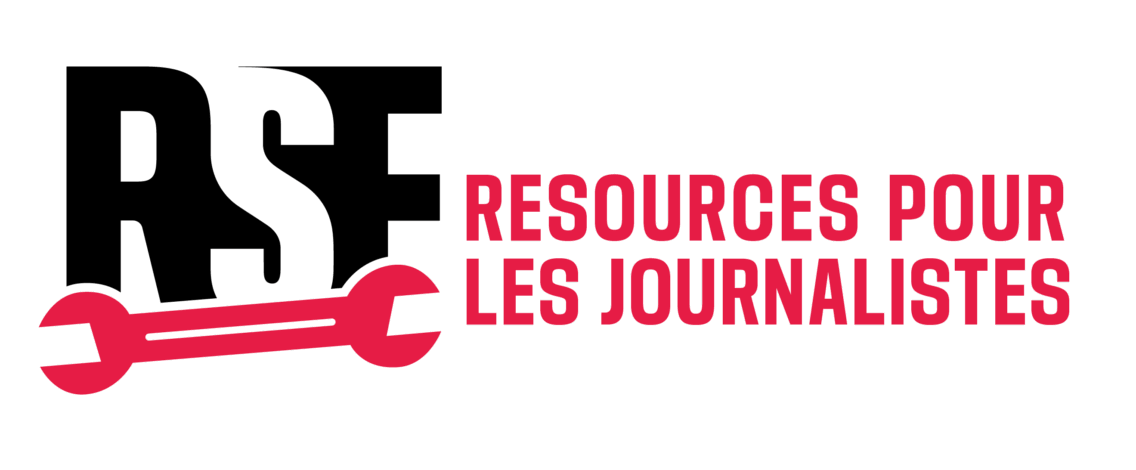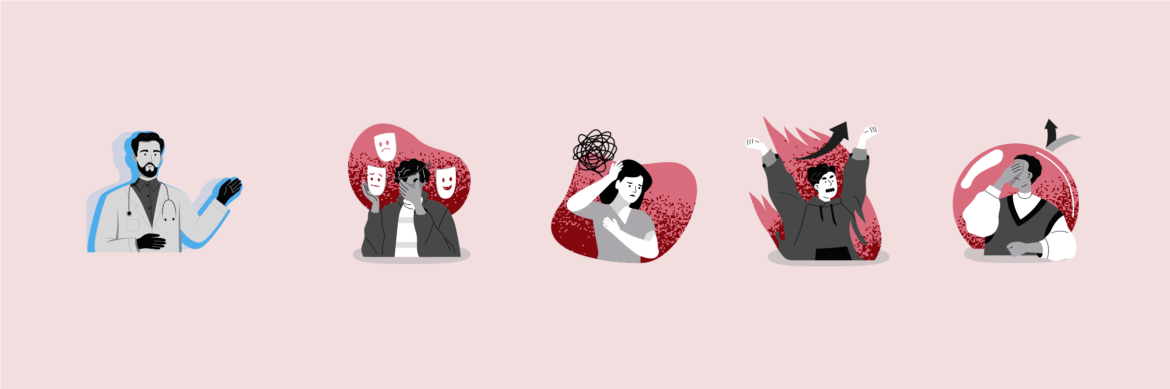Les journalistes sont souvent exposés à des événements violents ou tragiques dans le cadre de leur travail. Ces expériences peuvent provoquer des troubles physiques et psychologiques durables. Il est donc essentiel que les journalistes sachent reconnaître les signes du traumatisme afin d’y répondre de manière appropriée.
Les journalistes témoignent de catastrophes, de souffrances humaines et d’actes de violence. Ils entendent des récits et voient des images particulièrement choquantes, tout en prenant parfois des risques pour leur sécurité et leur liberté. Ces expériences peuvent entraîner une grande variété de réactions mentales et physiques, qui diffèrent selon les individus et peuvent apparaître dans les jours ou les mois suivant l’événement.
Réactions traumatiques à court terme
Dans les 24 premières heures après un événement traumatique, il est normal de ressentir des tremblements, des vertiges ou des nausées. On peut être en état de choc ou de confusion, voire souffrir d’amnésie temporaire rendant difficile le souvenir précis de ce qui s’est passé. Durant cette phase initiale de « fuite ou combat », la priorité doit être la sécurité immédiate. Il est important d’essayer de rester calme et de se concentrer sur les procédures de sécurité établies.
Une fois dans un environnement plus sûr, il convient d’appliquer les principes des premiers secours psychologiques : répondre d’abord aux besoins essentiels tels que se nourrir, boire, dormir, assurer sa sécurité et retrouver du soutien social. Il est recommandé de contacter des personnes de confiance et d’accepter leur aide afin d’alléger le fardeau mental et physique.
Réactions traumatiques à long terme
Si les réactions de stress initiales disparaissent généralement avec le temps, certaines peuvent évoluer vers des troubles plus persistants.
Trouble de stress aigu (TSA)
Au cours du premier mois suivant un événement traumatique, il faut être attentif aux signes de trouble de stress aigu (TSA), tels que l’anxiété ou la paranoïa. Les symptômes peuvent inclure des souvenirs intrusifs ou des images mentales envahissantes, des troubles du sommeil et des cauchemars, des palpitations, de l’irritabilité, une grande fatigue, des accès de colère ou une impression de détachement de la réalité. Dans certains cas, le TSA peut affecter la vie personnelle et professionnelle, conduisant à un repli social ou à l’évitement de toute activité susceptible de raviver le souvenir de l’événement.
Trouble de stress post-traumatique (TSPT)
Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) se caractérise par des symptômes de stress aigu qui persistent au-delà d’un mois. Ces réactions prolongées peuvent être profondément perturbantes et altérer la vie sociale, le sommeil, la concentration et la capacité à gérer des situations stressantes ou des informations choquantes. Les symptômes les plus courants incluent des troubles du sommeil et une dépendance à des aides au sommeil (alcool, somnifères), une amnésie dissociative partielle ou totale de l’événement, une dépression marquée par un état émotionnel négatif constant, une perte d’intérêt pour les activités importantes et un sentiment de détachement, une hypervigilance entraînant paranoïa ou anxiété excessive, ainsi que des comportements autodestructeurs dus à un sentiment de perte de contrôle ou à une perception altérée du danger.
Non traité, le TSPT peut entraîner des changements profonds de personnalité et l’apparition de troubles secondaires tels que les crises de panique, la dépendance à l’alcool ou aux drogues, les troubles alimentaires, les troubles obsessionnels compulsifs (TOC), les troubles dissociatifs ou les pensées suicidaires.
Toute personne présentant ces signes devrait consulter un professionnel de santé, médecin ou psychiatre, car les symptômes peuvent être durables et nuire gravement à la santé mentale.
Ressources pour faire face aux réactions traumatiques
Apprendre à réguler ses réactions émotionnelles et physiques après un traumatisme est un processus difficile et propre à chacun. Il est important de se rappeler que personne ne devrait affronter seul ces difficultés. Des ressources existent spécifiquement pour les journalistes confrontés au TSA ou au TSPT :
- Le Guide de sécurité de RSF, chapitre 6, section 10 : « Traumatisme psychologique : gérer le stress traumatique ».
- Le manuel du Dart Center, Journo Trauma Handbook, pages 10 à 17 : « Reporting Trauma – The Journalist ».
- La plateforme Find A Helpline, un répertoire mondial de lignes d’écoute et de prévention du suicide, proposant des services de chat, de messagerie et d’appels selon les pays et les besoins (traumatisme, dépression, anxiété, violence, dépendance, deuil, etc.).
Eutelmed, une plateforme internationale de téléconsultation médicale spécialisée dans la santé émotionnelle et mentale, propose des consultations sécurisées avec des professionnels de diverses cultures et expertises (stress, traumatisme, deuil, etc.).